Mise à jour le 16 nov. 2022
Publié le 11 octobre 2022 – Mis à jour le 16 novembre 2022
Les BU de Lyon 2 organisent des formations spécifiques pour les doctorants : Isidoc't d'une part (en collaboration avec Lyon 3 et l'ENS), et d'autre part, un module "Science Ouverte" destiné à les aguerrir aux outils et principes de ce thème. A travers ces portraits, nous en apprenons un peu plus sur leur sujet de thèse et l'intérêt des formations qu'ils ont suivies.

Pauline est doctorante depuis 2020 au laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI). Elle a suivi le module Science Ouverte qui s’est déroulé à la BU Chevreul de Lyon 2 les 2 et 3 mars 2022. Nous avons discuté science ouverte bien sûr mais aussi environnement de la recherche, doctorat ainsi que d’édition et de formation.
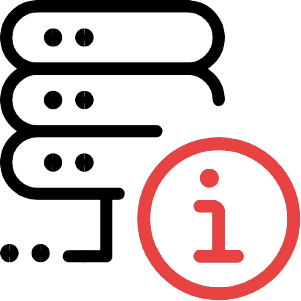 Retrouvez les détails de la formation Isidoc't et du Module Science Ouverte Retrouvez les détails de la formation Isidoc't et du Module Science Ouverte |
|---|
- Parcours universitaire et travail de recherche
-
- Pourriez-vous nous expliquer votre parcours universitaire ?
P. : Au départ je suis détentrice d’un BAC L, puis j’ai fait 3 ans de prépa littéraire et ensuite j’ai fait mon master à Lyon 2 : un master lettres modernes recherche. Je pensais passer les concours de l’enseignement et l’agrégation, ce qui n’a pas été le cas. Finalement, je me suis tournée naturellement vers le doctorat, j’ai un contrat doctoral qui me permet depuis 2020 de financer ma recherche.
Actuellement je suis en deuxième/troisième année de thèse et je travaille sur une maison d’édition de la deuxième moitié du XXème siècle nommée Le Soleil Noir. Elle est spécialisée dans le livre de tradition bibliophile, et publie notamment des formes artistiques et livresques que l'on appelle livres-objets. Je cherche à mettre en avant cette question de la rencontre et de l’amitié entre des artistes, des plasticiens mais également des écrivains et des poètes. C’est une thèse qui demande beaucoup de travail, j’ai un travail d’archives assez important parce que c’est une maison d’édition qui n’existe plus.
- Votre thèse est centrée sur cette maison d’édition ?
P. : Oui, je réalise un travail de recensement des collections. J’essaye de comprendre la matérialité des objets, ainsi que la dimension juridique et économique présente dans cette maison d'édition. Par exemple, le contrat entre un auteur et un plasticien, parce que l'on commence déjà à avoir un développement des politiques éditoriales, que l'on peut trouver aujourd'hui dans l'édition contemporaine. Je propose également un travail historique : il s'agit de dépeindre la généalogie de la maison d'édition, ainsi que sa filiation.
- Cette maison d’édition éditait des artistes plasticiens si je comprends bien ?
P. : En fait, elle éditait des formats textuels, des tracts à détruire, des manifestes poétiques, des recueils poétiques, quelques romans tout de même. En parallèle, il existe des séries éditoriales qui prennent en compte la diversité du portrait sociologique du lecteur. La série A proposait des tirages de luxe dont des sculptures artistiques au tirage restreint, renfermant en leur sein le livre : c'est ce que l'on appelle des livres-objets, qui ne sont donc pas tout à fait des livres et pas tout à fait des sculptures. On est dans un entre-deux. Mon but c’est justement de revaloriser cette forme artistique parce que souvent dans la critique d’histoire du livre on se limite aux livres de dialogues, aux livres illustrés ou encore aux enjeux du livre d’illustration et de l’auto-illustration mais on en oublie souvent le livre-objet qui fait partie de ces catégories un petit peu à part, rapidement mis de côté, considéré comme une sculpture rapidement évincée de l'histoire du livre.
- Finalement, qu’est-ce qui vous a motivé à vous inscrire en doctorat ?
P. : C’est une très bonne question ! Je pense que c’est le fait d’arriver en 2020 avec le Covid, j’avais déjà réfléchi sur ce projet, c’était quelque chose que j’avais déjà abordé avec mon directeur de mémoire qui est maintenant mon directeur de thèse. C’était vraiment l’envie de travailler sur une maison d’édition, j’avais envie de mettre en pratique une certaine théorie. Il me manque encore la pratique, c’est sûr que ça viendra avec un projet professionnel plus abouti. J’avais envie de faire des conventions de séjours dans une maison d'édition, de travailler sur des objets particuliers et avoir cette compréhension de mon sujet de manière pragmatique, sortir de la description ou de la pensée, ce qui arrive fréquemment quand on travaille sur des objets matériels en histoire du livre.
- Votre thèse c’est le prolongement de votre travail de master ?
P. : C’est une forme de prolongement, car j’avais déjà travaillé justement sur des collaborations éditoriales, mais plutôt sur des artistes de fin de siècle, notamment Jules Laforgue et j’avais abordé en parallèle deux plasticiens, qui étaient dans mon corpus de base. Je me suis rendu compte en les étudiant qu'ils avaient été édités au Soleil Noir. Je trouvais cela étrange, car hormis un catalogue sur la maison d'édition paru dans les années 1990, je n'avais pas trouvé grand-chose. C'est à partir de là que j'ai glissé naturellement du mémoire à la thèse.
- C’est grâce à cette absence de bibliographie que vous avez voulu creuser le sujet ?
P. : Oui exactement.
- Pourriez-vous nous expliquer votre parcours universitaire ?
- Sur la science ouverte en générale et la publication en particulier
-
- Comment avez-vous eu connaissance du module Science Ouverte que vous avez suivi à la BU ?
P. : Tout simplement par mon école doctorale, j'étais assez curieuse de découvrir ce qu'était la science ouverte parce que je ne connaissais pas du tout. Ce n’est pas un sujet abordé en éthique de la recherche, ce que je trouve assez dommage. Je pense qu'il s'agit d'une lacune. J’avais envie d’apprendre et de voir aussi quels sont mes droits en tant qu’autrice : on a tendance à oublier que l'on en a encore sur nos productions lorsqu'on les propose à des revues, même si on s'engage à respecter le contrat éditorial. Il y a une démarche également plus personnelle : celle de lutter contre des logiques prédatrices. Je n’ai jamais été, et heureusement, confrontée directement à celles-ci. Je suis en cours de parution avec une collègue et nous n'avons pas du tout ressenti cela lors de nos échanges avec les responsables et les membres du comité éditorial, ni dans le retour des évaluateurs lors de la double aveugle* mais c’est quelque chose qui peut arriver en doctorat parce que justement nous sommes dans une situation où on peut avoir un peu le syndrome de l'imposteur : la peur de l'échec, de ne pas être publié, la question de la poursuite de carrière, entre autres.
- Oui justement comme vous êtes « apprenti chercheur », vous n’avez pas encore toutes les clés pour être vigilant vis-à-vis des éditeurs prédateurs et c’est ce qu’on essaye de vous faire pointer du doigt. On le fait dans cette formation mais aussi dans Isidoc’t.
P. : C’est vrai que c’est une formation qui m’a beaucoup apporté parce que le fait d’avoir un historique de ces pratiques-là de science ouverte c’est quelque chose qui est neuf, qui est très contemporain, récent et en même temps prometteur.
On trouve aussi cet enjeu de la qualité dans la production, qui ressortait lors de la formation et que l’on ressent aussi quand on est doctorant. Pour en avoir discuté avec certains de mes collègues c’est ça qui ressortait, cette envie de produire moins mais de la meilleure qualité, avec la reconnaissance d’un travail bien fait.
- C’est vrai que c’est important, c’est aussi quelque chose qui est peut-être encore plus important en science humaines et sociales et sur lequel on a voulu mettre l’accent parce que le facteur d’impact par exemple c’est très utilisé en sciences dures, mais les SHS se trouvent un petit peu mis en retrait par rapport à ça.
P. : Oui, par exemple la relecture en double aveugle est quelque chose qui n'est pas à exclure radicalement. On peut le critiquer, par moments, cependant je trouve qu'il est bien de conserver l'anonymat. On est relu par deux professionnels qui ne nous connaissent pas ; on ne connaîtra pas non plus leur identité ; c'est en somme assez valorisant, parce que seul le texte fera l'objet de retours qui peuvent améliorer le papier, faire mûrir d'autres réflexions, nous obliger aussi à faire preuve davantage de justesse ou d'esprit critique en nous mettant à la place du lecteur. Cela fonctionne plutôt bien ; cependant je ne suis pas assez expérimentée pour réellement l'attester. Concernant les SHS vous avez raison, ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder du côté des habilitations à la recherche pour les MCF* par exemple. Vous avez encore aujourd'hui des tableaux avec des critères, comme les revues à fort impact. En tant que doctorant, on a au moins un jour tous regardés ce tableau en se demandant : « est-ce que cette revue fonctionnera ou pas ? Ai-je des chances ? Est-ce que je mise sur le bon cheval ? » C'est bien dommage de s'inscrire dans une logique dont on ne peut pas s’échapper.
- On ne reprochera pas aux doctorants ou aux chercheurs d’avoir une stratégie de publication parce qu’ils ont aussi en tête des logiques de carrière et de recrutement, c’est tout à fait légitime. Maintenant, il y a des choses qui se pratiquent en termes d’avenant à des contrats et ce qui est important sur cette formation science ouverte, c’est que l’édition essaye de développer ces aspects en mettant des avenants à des contrats d’édition avec des clauses orientées science ouverte, c’est vraiment important. Si vous avez à rédiger des contrats d’édition, comme vous êtes des deux côtés de la barrière, c’est important d’y penser.
P. : Oui, je suis entièrement d’accord avec vous et ça permet de sortir de cette stratégie "à la Gallimard" finalement. Elle est vraiment axée sur cette prédation. Même si ce n’est pas la seule maison d’édition en littérature contemporaine qui a cette logique-là des étalons, présenter souvent les mêmes auteurs dans sa collection blanche parce que ce serait prestigieux socialement.
- La science ouverte c’est un débat que vous avez avec vos collègues ?
P. : Oui, on a parfois cette discussion. Parler de science ouverte c'est un moyen également de réinterroger toutes ces pratiques et de dire que l’on peut avoir d'autres critères tout autant légitimes, de qualités ; choisir de ne pas rentrer dans des logiques de carrière ou alors privilégier une forme alternative de recherche. Oui, c’est quelque chose dont on parle parce que justement, il y a ce rapport au temps en doctorat qui est très difficile à gérer. En même temps, nous devons accorder un temps de thèse, un temps de publication, et un temps de valorisation de la recherche ; ça fait beaucoup. Donc en parlant de science ouverte, on arrive aussi à réinterroger ce rapport au temps. Là par exemple je suis en train de rédiger deux articles : je préfère en publier deux ou trois plutôt que dix parce qu'en termes de temps ce n’est pas possible pour moi, mais pour la qualité, ça ne l'est pas non plus il me semble. C’est un débat que l’on a souvent avec mes collègues doctorants ; on est tous d’accord avec ces principes de science ouverte ; on s’est documenté sur la question ou on commence à le faire.
- Comment avez-vous eu connaissance du module Science Ouverte que vous avez suivi à la BU ?
- Sur les formations au cours du doctorat
-
- À un moment vous avez parlé « d’éthique de la recherche » vous avez déjà suivi une formation là-dessus ?
P. : Oui, c'est une formation obligatoire. Il y a un arrêté qui existe depuis plusieurs années qui vous oblige en tant que doctorant à passer celle-ci, pour le moment elle est sous forme de MOOC, mais vous pouvez aussi la suivre en présentiel, tout dépend des universités. En tout cas, pour ma part, cette formation a été organisée par la COMUE. En revanche la science ouverte n’est pas du tout abordée ce qui m’a assez surprise, d’où le fait d’avoir choisi de suivre cette formation. Je trouvais qu’il manquait cet aspect.
- Souvent la démarche se fait de l’enseignant envers le doctorant, mais est-ce que vous en tant que doctorante vous pouvez avoir un impact sur les enseignants titulaires ? Est-ce que vous aussi vous ne pouvez pas avoir un rôle d’information, de sensibilisation auprès des enseignants-chercheurs ?
P. : Ça serait bien, idéalement, mais c’est vrai que je n’ai pas encore eu l’occasion d’en parler à mon directeur de thèse. Ce ne sont pas des conversations que l’on a immédiatement et fréquemment avec des titulaires. Je pense que cela dépend aussi du contexte ; personnellement je n’ai pas encore trouvé ce moment précis pour pouvoir en discuter.
- Les formations dans le doctorat prennent-elles beaucoup de place ?
P. : Oui, vous devez réaliser 42h de formations transversales. Une formation sur la science ouverte peut déboucher sur des heures de formation validées. Et il y a aussi les formations disciplinaires. Il faut compter 80h. C'est beaucoup ; cela se fait sur plusieurs années, il faut donc s’organiser. Il est fortement conseillé de les réaliser en première année quand on a le temps parce qu’après, avec la rédaction de la thèse, il est beaucoup plus difficile, voire pénible, de le faire. Oui ça nous occupe !
- Vous les trouvez intéressantes, utiles ?
P. : Oui ! J’avais suivi la bibliographie et le référencement, entre autres. Je pense que c’est important, une remise à niveau, parce qu’on n’a pas forcément le même champ disciplinaire et pas forcément non plus les mêmes normes bibliographiques à appliquer.
- À un moment vous avez parlé « d’éthique de la recherche » vous avez déjà suivi une formation là-dessus ?
- Sur le module science ouverte spécifiquement
-
- Concernant les formations de science ouverte que vous avez suivies à la BU, lesquelles vont vous être ou vous sont déjà le plus utile dans votre quotidien de jeune chercheuse ?
P. : Si je devais choisir, je dirais déjà que j’ai beaucoup apprécié l’historique de la science ouverte parce qu'il est nécessaire d’avoir ces bases pour comprendre pourquoi on en est là aujourd’hui. La formation a été utile. Pour moi, tous les aspects vus lors de la formation sont indistincts : on doit prendre en compte ce processus, cette continuité, cette histoire. Il était pour moi impensable de ne pas suivre la formation sur les deux jours parce que je pense que j'aurais perdu des éléments primordiaux. La question des données sensibles m'a également marquée, parce que j'ai eu l'occasion de faire des entretiens : savoir que l'on a des données sensibles et savoir aussi les exploiter en respectant le consentement de la personne, c'est crucial. Je ne vais pas forcément tout dévoiler, divulguer : je vais peut-être garder des éléments privés pour moi, si j'estime que cela touche à l'intégrité des concernés. Donc c'est très intéressant d'avoir mis l'accent sur cet aspect, outre la gestion et l'analyse des données. On montre aussi, outre des données statiques, qu'il existe des critères mouvants parce qu'on est face à un individu ; ce n'est pas une statistique.
- Est-ce qu’il y a des choses également qui vous ont manqué ?
P. : Je n’ai pas senti de manque. J’ai beaucoup apprécié la mise en pratique, notamment pour IDHAL ou pour ORCID ; c’est utile d’avoir des démonstrations et assez rassurant. Certes, je n’ai pas encore fait mon compte parce que je suis en cours de publication et que ce processus est assez long : j’aurai pu commencer mais je préférerais déjà avoir les éléments requis. Je trouve qu’il ne manquait rien du tout. Pour moi, ça brossait toutes les problématiques et les thématiques et nous permettait également d’avoir encore des interstices à explorer, de continuer le raisonnement même après, au fur et à mesure de la pratique personnelle.
- Concernant les formations de science ouverte que vous avez suivies à la BU, lesquelles vont vous être ou vous sont déjà le plus utile dans votre quotidien de jeune chercheuse ?
- Sur la bibliothèque
-
- Quelle place prend la bibliothèque dans votre travail de recherche ?
P. : C’est presque ma "deuxième maison", c’est mon outil de travail, j’ai souvent besoin de faire des aller-retours, parfois je travaille sur place, parfois non. Mais oui, bien sûr les bibliothèques occupent une place importante.
- Vous fréquentez Lyon 2 et Diderot j’imagine ?
P. : Oui. Je vais aussi à l’Enssib parce qu’ils ont une bonne collection consacrée à l'histoire du livre et des éléments précieux pour mes recherches. D'ailleurs, je vais souvent dans ces trois bibliothèques.
- Quelle place prend la bibliothèque dans votre travail de recherche ?
* MCF : maîtres de conférences.
Propos recueillis par Raphaëlle Billy et Christelle Caillet
Une question ?
Bibliothécaires En Ligne
Bibliothécaires En Ligne




